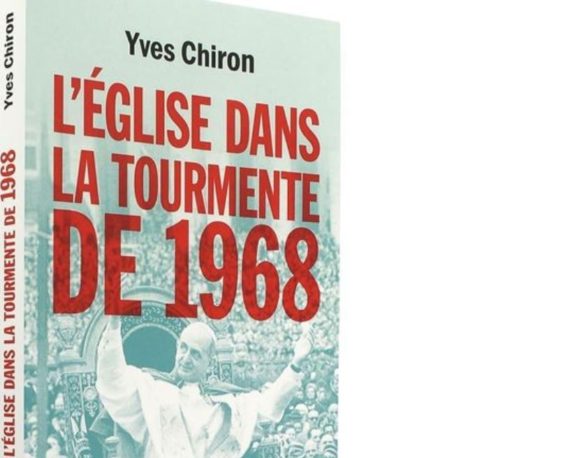[size=32]Pourquoi Mai 68 n’est pas responsable de la désaffection des églises[/size]
Propos recueillis par Youna Rivalain - publié le 09/04/2018
Dans les années 60, la pratique catholique connaît un véritable effondrement. Souvent associée à Mai 68, cette rupture puise cependant ses origines dans les bouleversements initiés par le concile Vatican II en 1965. Dans Comment notre monde a cessé d'être chrétien. Anatomie d'un effondrement* , Guillaume Cuchet, professeur d'histoire contemporaine, analyse les causes de cette crise.

 AFP
AFPVous évoquez une crise de la pratique religieuse qui serait advenue non pas avec Mai 68 ou l'encyclique Humanae vitae de Paul VI sur la contraception la même année, mais en 1965. Sur quelles données basez-vous ce constat ?
J'ai travaillé dans les archives du chanoine Fernand Boulard, prêtre et spécialiste des questions sociologiques pour l'épiscopat. Il a piloté des enquêtes sur la pratique religieuse dans tous les diocèses de France entre 1945 et 1965. Au terme de son travail, il avait conclu à la stabilité globale des taux de fréquentation des églises dans la longue durée, malgré une pente légèrement déclive dont les origines remontaient à la Révolution. Cependant, au milieu des années 1960, contre toute attente, ces courbes ont plongé. Voilà le point de départ de mon travail. Ainsi, cinquante ans après les conclusions de Boulard, je me suis efforcé de vérifier son diagnostic de l’époque et d’avancer quelques hypothèses sur ce décrochage massif de la pratique.
Avant le concile, la pratique religieuse était obligatoire sous peine de péché mortel. En quoi le changement initié par Vatican II a-t-il induit une baisse conséquente de la pratique elle-même ?
La pratique est une obligation canonique pour les catholiques. Elle faisait partie de ce qu’on appelait les « commandements de l'Église » : pratique dominicale, c'est-à-dire aller à la messe le dimanche, et pascale (faire ses Pâques), donc communier au moins une fois par an, après s'être confessé.
Conséquence indirecte du concile, l'Église a brutalement beaucoup moins insisté que par le passé sur ces obligations. Elle s'est mise à considérer que la pratique en tant que telle était relativement secondaire, que l’important était la participation, les comportements évangéliques, les engagements sociaux ou politiques. À ce moment-là, plusieurs générations de chrétiens, formées dans ce système de l'obligation, ont décroché. Je pense que c'est plutôt ce changement du sens de la pratique, avec son insistance nouvelle sur la liberté individuelle et une approche plus complexe de la pratique, qui a contribué à faire plonger les taux de fréquentation.
Vous évoquez la disparition d'une « pastorale de la peur » basée sur l'enseignement du péché originel, du jugement particulier, de l'enfer et du purgatoire, au profit de l'image d'un Dieu tout amour et d'une importance plus marquée du dialogue interreligieux. Diriez-vous que le catholicisme moderne est devenu plus responsabilisant pour les fidèles ?
Dans ses analyses des années 1970-80, l’historien Jean Delumeau a insisté sur le fait que la christianisation de masse de l'Occident s'était souvent faite à coup de « pastorale de la peur » en insistant sur les aspects les plus inquiétants du christianisme. Il laissait ainsi entendre que l'Occident n’avait été christianisé qu’en surface, par la peur plus que par les convictions profondes. D’où la déchristianisation du XXe siècle qui, en un sens, était une réaction compensatrice potentiellement salutaire.
Je pense qu'il y a là une part de vérité : le catholicisme pré-conciliaire était très articulé à une prédication des « fins dernières » qui donnait lieu à une pastorale très dramatisée. Un des aspects les plus étonnants du Concile est d'avoir occulté totalement les « fins dernières », qui étaient pourtant jadis des sujets centraux dans la prédication, la catéchèse et la spiritualité catholiques. Tout à coup, on a cessé d'en parler, et on a alors beaucoup insisté sur l'engagement et l'ouverture au monde.
L'autre élément qui a dû jouer est l'accent mis sur la liberté religieuse. Un certain nombre de chrétiens y ont vu comme une sorte de droit nouveau à « faire le tri » dans les vérités de la foi et les pratiques d’obligation. À la suite du concile, ils se sont mis à « bricoler » dans leur catéchisme en laissant tomber ce qui leur déplaisait ou leur paraissait improbable, d’autant que le clergé lui-même avait l’air de ne plus y croire.
Vous évoquez une crise du sacrement de réconciliation au moment de Vatican II. Comment percevez-vous alors le pontificat du pape François, dont la miséricorde est une des clés du message, en particulier avec le Jubilé de la Miséricorde et le retour du sacrement de réconciliation.
C'est un des aspects les plus spectaculaires des années 60 en matière religieuse : ce sacrement qu'on appelait « sacrement de pénitence », rebaptisé « sacrement de la réconciliation », a très mal vécu la transition. Les taux de confession se sont effondrés, alors qu'elle occupait un rôle central dans la vie de l'Église : elle était, avec les enterrements, le sacrement qui occupait le plus le clergé. Tous les confessionnaux étaient pris d'assaut à la veille des grandes fêtes du calendrier liturgique !
Aujourd'hui, il semble que l’on observe un mouvement de redécouverte de la confession vue avant tout comme sacrement de la miséricorde. Cela va de pair avec les transformations du catholicisme contemporain. La jeune génération, qui n'a rien connu de la situation pré-conciliaire, récupère des éléments qui avaient été écartés dans la mutation : la soutane, le latin, le confessionnal, etc. Mais ce n'est pas un retour pur et simple à la situation antérieure au Concile : c’est plutôt une sorte de catholicisme vintage !
La carte Boulard souligne des disparités régionales importantes : est-ce toujours le cas après la rupture de 1965 ?
La rupture a rééquilibré les régions avec un nivellement par le bas. Avant les années 60, les contrastes régionaux étaient spectaculaires. Aujourd'hui, les disparités subsistent, mais elles sont bien moindres qu’il y a 50 ou 60 ans. Dans beaucoup de régions rurales et/ou montagneuses, le catholicisme a quasiment disparu, en partie à cause de la crise des vocations qui ne permet plus d'entretenir le maillage paroissial, obligeant des fidèles, souvent âgés, à faire beaucoup de route pour aller à la messe. La crise des vocations a laminé certaines régions, tandis que d'autres ont mieux défendu leurs positions.
Qu'en est-il des disparités sociologiques au regard de la pratique ?
Dans les années 50, le catholicisme était représenté dans tous les milieux, non sans fortes disparités. Le clergé s'inquiétait notamment de la sous-représentation des catholiques dans le monde ouvrier censé détenir les clés du « monde de demain ». Aujourd'hui, les contrastes sociologiques existent toujours et, pour des raisons qui tiennent à la transmission de la foi, le christianisme semble s'être mieux perpétué dans une certaine bourgeoisie classique qui continue de jouer un rôle majeur dans la vie catholique française.
Inversement, le catholicisme populaire « autochtone » a beaucoup décru. Le catholicisme français a donc désormais tendance à se polariser autour d'une certaine bourgeoisie d'un côté, et de paroisses populaires nourries par l'immigration chrétienne de l'autre – ce qui n'est pas représentatif de la société française dans sa diversité et sa complexité.
Les premiers à avoir décroché sont les jeunes de la génération du baby boom. Pourquoi eux ?
Dans les années 50, 80 % d’une génération faisait sa communion solennelle à 12 ans, moyennant 3 ans de catéchisme avec messe obligatoire. Le lendemain même de la communion solennelle commençait la grande dégringolade : elle était le point d'orgue de la pratique, après quoi les enfants faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Le clergé, qui le savait, considérait comme de son devoir d’injecter aux enfants une dose massive de religion parce qu’on ne les reverrait plus de sitôt.
C'est dans ce contexte que les baby-boomers arrivent, très nombreux : entre 800 000 et 850 000, c'est-à-dire 200 000 de plus que dans les années 30. Comme les autres, ils font leur communion solennelle, mais décrochent ensuite beaucoup plus que leurs aînés.
Il existe plusieurs explications possibles : d'abord leur nombre et leur adéquation avec la société de consommation propre aux Trente Glorieuses (1954-1975), créant un décalage culturel au sein des familles. Cette génération est également plus éduquée que ses parents, l'âge de la scolarité obligatoire étant passé à 16 ans en 1959. De son côté, l'Église insiste moins que par le passé sur l'obligation de la pratique. L'un dans l'autre, les piétons de mai 68 ont commencé par être les décrocheurs de la communion solennelle dans les années 60 !
Cette crise serait-elle advenue sans le Concile ? Était-elle inévitable ?
Cette crise est internationale : elle s'est produite dans beaucoup de pays occidentaux, de culture catholique ou protestante majoritaire. C'est une crise générale ayant des causes socio-culturelles comme la modernisation de la société ou la hausse du niveau éducatif. Mais en France, le Concile a contribué à en fixer le calendrier et à lui donner une intensité particulière. L'Église catholique était une vieille institution conservatrice qui se faisait gloire de ne pas changer, qui était supposée immuable comme la vérité, etc. Et voilà que, tout à coup, elle changeait profondément, non sans susciter un certain scepticisme chez beaucoup de personnes qui se sont demandées ce qu'on leur avait raconté par le passé et si l’Église savait bien ce qu’elle disait.
Vous invitez les familles à réaliser des monographies familiales pour étudier la transmission de la foi et de la pratique religieuse en leur sein…
C’est en effet un exercice qui peut être très éclairant, à la fois pour soi et pour l’histoire générale de la période. Chacun peut dresser son arbre généalogique spirituel et voir sur trois ou quatre générations comment les choses ont évolué dans sa famille, pourquoi la foi s’est transmise ici et pas là, etc. La clé de beaucoup des énigmes qui nous occupe est familiale.
(*) Comment notre monde a cessé d'être chrétien. Anatomie d'un effondrement* , Guillaume Cuchet (Seuil, 2018).
Édition n° 88

 Accueil
Accueil