Trois questions pour comprendre la polémique autour des successions et du mariage de la musulmane avec le non-musulman
Publication: 30/08/2017 13h17 CEST Mis à jour: 30/08/2017 13h17 CEST TUNISIAN WOMEN Rarement, une polémique aura suscité autant de passions et de déchirements entre les acteurs sociaux et politiques. Et pour cause, l'on débat de "la femme", cette "moitié dangereuse", comme disait Georges Balandier. Dans l'histoire contemporaine de la Tunisie et des autres pays musulmans, trois sujets brûlants ne cessent, depuis l'avènement de "la renaissance arabe" ("al-nahdha al-'arabiya") au milieu du XIXème siècle, d'agiter l'opinion publique: la femme, la langue et le gouvernement des Hommes ("h'ukm siyâssî"). Lors de ces débats diffusés par les livres et les mass-média - anciens et nouveaux -, tout se cristallise autour de l'islam, afin de justifier ou de rejeter l'innovation et la modernisation. L'islam qui serait inaltérable et intouchable pour certains, discutable et évolutif pour les autres.
Le discours du président de la république, Béji Caïd Essebsi, prononcé à l'occasion de la fête nationale de la femme, le 13 août 2017, était axé sur la nécessité de parvenir à l'égalité entre hommes et femmes, en amendant les dispositions relatives aux successions et au mariage de la musulmane avec le non-musulman.
Avec le temps, ce discours aura eu le mérite de faire bouger les lignes de partage et de clarifier les positions des protagonistes. Non pas que le sujet abordé soit inédit, ou tabou. Loin de là, puisqu'il a été déjà discuté largement, au moins à quatre reprises:
- Par Tahar Haddad dans son célèbre opuscule "Notre femme dans la législation islamique et la société" (1930), avec une position claire et avant-gardiste: même si l'islam a privilégié l'homme dans les successions, l'évolution de la condition féminine plaide pour la justice et l'égalité entre les hommes et les femmes, d'autant plus que l'islam, religion évolutive, accepta d'amender le statut des esclaves.
- Par le leader et président Habib Bourguiba qui voulait, au début des années 1970, compléter la réforme du Code du statut personnel (1956) et trouver une issue à la "règle coranique" de l'inégalité successorale, par laquelle la femme hérite de la moitié de la part du mâle. Mais le "combattant suprême" fut conseillé par ses proches de ne pas s'attaquer à cette question minée, au risque de susciter une polémique, plus forte encore que celle du jeûne de Ramadan qu'il avait affrontée autour de 1960, avec la désapprobation des milieux conservateurs en Tunisie et au Moyen-Orient.
- Par les associations féministes, l'ATFD (l'Association tunisienne des femmes démocrates) et l'AFTURD (l'Association des femmes tunisiennes universitaires pour la recherche et le développement), qui ont eu l'idée d'en débattre et de réclamer, autour de l'an 2000, le changement des clauses juridiques entérinant les discriminations de genre, lors de plusieurs réunions, réflexions et colloques, sur la base de recherches, d'enquêtes et de publications dont un plaidoyer intitulé Egalité dans l'héritage. Pour une citoyenneté pleine et entière, 2 volumes, 2006.
- Par une initiative législative présentée en 2016, par vingt-sept députés, à l'Assemblée des représentants du peuple, en vue de la révision des parts des successions, avec un projet de trois articles instituant l'égalité successorale. Cette initiative proposée par le député Mehdi Ben Gharbia fut refusée par la majorité des élus ainsi que par le Mufti de la République.
Le discours présidentiel du 13 août 2017 propose un débat autour de la double question de l'héritage et du mariage de la musulmane avec le non-musulman, en instituant une Commission spécialisée dans les libertés individuelles et l'égalité, présidée par la députée et militante féministe, Bochra Bel Hadj Hamida.
En poursuivant l'objectif de parvenir à l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est un nouveau combat historique qui se profile, en renouant avec le rôle pionnier de la Tunisie dans les réformes sociales et politiques. La tâche sera probablement rude en raison de la résistance des conservateurs - religieux et non-religieux -, en Tunisie et ailleurs. Cependant, le débat est déjà engagé et les verrous ne manqueront pas, tôt ou tard, de sauter, étant donné l'évolution du statut de la femme et la conviction partagée par la majorité des élites politiques et de larges secteurs de la société tunisienne, d'aller au-delà de l'inégalité de statut qui est devenue, de nos jours, en contradiction criante avec le rôle croissant des femmes dans la vie active.
La polémique autour des successions et du mariage de la musulmane et du non-musulman s'inscrit dans le cadre de l'espace public pluriel. En tant que structure politique de la société civile, l'espace public est le garant de la démocratie, en cette phase délicate de la transition. C'est dire l'importance d'un tel débat pour le présent et l'avenir du pays et de l'islam qui se trouve, au défi de la modernité, contraint d'évoluer et d'épouser le nouveau contexte de la globalisation marqué par la libre circulation des marchandises, des signes et des idées.
Reste à connaître de près, pour mieux avancer, la nature de cette polémique initiée par le haut - la présidence - et instruite par les citoyens - la société civile -, avec pour point de départ l'interrogation suivante: quels en sont les acteurs, les défis et les enjeux? Pour ce faire, trois questions méritent d'être mises au clair, à savoir:
1.Une polémique civile ou religieuse?
L'initiative de débattre de la double question des successions et du mariage de la musulmane et du non-musulman se situe, comme l'a précisé le Président de la République dans son discours du 13 août, en continuité avec l'esprit de la nouvelle Constitution ainsi que de l'évolution de la condition féminine qui est devenue une réalité sociologique mise en évidence par des statistiques: 75 députés sur un total de 217, 60% des cadres médicaux, 41% des magistrats, 43% des avocats et 60% des diplômés de l'université sont des femmes.
Sans les avoir cités dans son discours, trois articles de la Constitution de 2014 plaident pour l'égalité. Ce sont les articles 21, 6 et 3. Il est vrai que le Président avait référé à l'article 46 par lequel l'État s'engage à protéger les droits acquis de la femme, œuvre à réaliser la parité entre la femme et l'homme dans les conseils élus et prend les mesures pour éradiquer la violence.
D'ailleurs, l'initiative présidentielle complète la récente loi contre les violences et les discriminations à l'égard des femmes adoptée au mois de juillet, en conformité avec la Convention CEDAW - dont le gouvernement tunisien avait auparavant levé les réserves.
De son côté, l'article 21 dispose que les citoyens et les citoyennes, sont égaux en droits et devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans discrimination aucune. Dans l'article 6, l'État garantit la liberté de croyance, de conscience et le libre exercice des cultes. Enfin, pour l'article 2 qui est fondamental et qui ne peut être amendé, exactement comme l'article premier, la Tunisie est un État à caractère civil, basé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté du droit. Si l'on ajoute à ces références constitutionnelles, le fait que la proposition vient du pouvoir exécutif, que la commission nommée à ce propos est composée entièrement de non-religieux et que l'objectif est de parvenir à l'égalité citoyenne, la polémique engagée s'avère, en première et dernière instance, comme étant une polémique civile et non pas religieuse.
C'est à la Commission de choisir la meilleure voie pour réaliser ses objectifs: se situer au niveau du registre de la religion, comme le fit Bourguiba pour finaliser sa stratégie réformiste de "Grand Djihad", ou bien se limiter à un plaidoyer purement civil en conformité avec la nature de la question de l'égalité ou, encore, user des deux registres.
Le comble de l'ironie dans la législation en vigueur est que la Tunisienne, pour la circulaire de 1973, est définie en tant que musulmane alors que la religion n'est pas l'attribut de la citoyenneté, ni dans la Constitution de 1959, ni dans celle de 2014, même si l'islam y est proclamé comme "la religion de la Tunisie". Sans parler de l'hypocrisie sociale et de la contrainte juridique exercée sur les prétendants au mariage avec les musulmanes de se convertir à l'islam devant le Mufti qui leur délivre, le cas échéant, un "vrai faux" certificat d'islamité. Cette procédure tragi-comique en dit long sur l'impasse d'une religion qui s'est vidée progressivement de sa vocation spirituelle pour devenir un "islam de marché", selon l'expression de Patrick Haenni.
Le discours du Président suscita une levée de boucliers de ceux qui se réfèrent au texte coranique pour légitimer leur refus et indignation du projet d'amender le CSP et de réaliser l'égalité entre hommes et femmes. Il en fut de même de leurs prédécesseurs au moment de la publication du livre novateur de Tahar Haddad et également de l'adoption du CSP abolissant la polygamie et la répudiation. À leurs yeux, les règles successorales ("ahkâm al-mawârith") et les interdictions du Coran sont claires et inaltérables. Elles énoncent, dans le verset 11 de la Sourate des Femmes que "Dieu vous recommande, en ce qui concerne vos enfants: aux mâles l'équivalent de la part de deux femmes.. " et, dans le verset 221 de le Sourate de La Génisse ("Al-Baqara") "N'épousez pas les femmes associantes ("mûshriket") tant qu'elles n'auront pas cru. Une esclave croyante vaut mieux qu'une femme libre associante, quand bien même celle-ci vous plairait davantage. Ne donnez pas vos filles aux associants tant qu'ils n'auront pas cru. Un esclave croyant vaut mieux qu'un incrédule libre, quand bien même il vous plairait davantage".
Les plus doctes parmi les connaisseurs du texte coranique vont plus loin, en détaillant les règles successorales et en montrant que les femmes peuvent, dans certaines situations, disposer de plus que la moitié des parts, prévue initialement.
Or, la question est de savoir si la polémique vaut la peine d'être reproduite telle quelle, dans le temps. Autrement dit, est-ce que le référent religieux - du Fiqh musulman - doit présider, comme dans les discussions précédentes, l'argumentaire politique et constitutionnel ou bien, est-ce que celui-ci doit se limiter à la dimension civile. Si tel est le cas, la polémique aura changé de perspective. Pour la première fois de l'histoire, elle s'imposera comme un débat purement civil et citoyen. L'avantage, dans ce cas précis, est que les sécularistes ne seront pas obligés, pour justifier leur position, de convoquer le texte religieux qui est, par définition, ambivalent, comme le sont par définition tous les textes - religieux et laïcs - dont l'interprétation dépend du lecteur et du contexte, des intérêts et des stratégies des acteurs.
2. Les acteurs de la polémique: qui contre qui?
Le discours du 13 août 2017 fut approuvé, dans la foulée, par l'islam d'État, représenté par le Mufti de la République. En conformité avec la tradition politique et historique, les hommes de religion s'alignent sur la position officielle. Ils sont nommés et payés par l'État qui gère les affaires publiques, civiles et religieuses. La nouvelle Constitution stipule, dans son article 6, que "l'État est le gardien de la religion", en garantissant la liberté de croyance, de conscience et le libre exercice des cultes. L'islam officiel n'a certes plus aujourd'hui la même prégnance que celle de la période de l'ancien régime mais l'idéologie du contrôle étatique persiste. Et il est frappant de voir comment les officiels religieux et aussi séculiers, changent de position, une fois qu'ils ne sont plus dans les sphères du pouvoir. Il en est ainsi de l'ancien Mufti, Hamda Saïd, qui s'est allié à l'ancien ministre des Affaires religieuses, du temps de la troïka, Noureddine El Khadmi, et Abdallah Loussif, l'ancien président du Conseil islamique supérieur, pour se réclamer de l'ancienne université-mosquée de la Zaytouna et s'opposer à l'initiative du Chef de l'État, considérée comme une atteinte aux principes de l'islam, dans un communiqué diffusé à l'issue d'une conférence de presse, signé par "l'Association des imams pour la modération et le rejet de l'extrémisme" et "l'Association des Cheikhs de Tunisie".
Pour ce qui est justement des positions politiques et idéologiques concernant l'égalité hommes-femmes, débattue au travers des dispositions juridiques en vigueur, celles des successions et du mariage de la musulmane avec le non-musulman, il existe trois tendances qui sont différentes et opposées:
- La première tendance est celle qui se veut réformiste et moderniste, en faveur du changement et de l'amélioration du statut de la femme, de sorte à parvenir progressivement à l'égalité. Cette position est traduite par l'appel du président à réviser le CSP ainsi que la circulaire de 1973 empêchant légalement le mariage de la musulmane avec le non-musulman. Elle est également partagée par tous les bourguibistes et les intellectuels modernistes, qu'ils soient modérés ou de gauche, en faveur de l'émancipation de la femme. C'est dans ce sens que la plupart des associations de la société civile ont appuyé le discours du Chef de l'État et appelé à une concrétisation des droits de la femme en vue d'une citoyenneté entière et assumée. Les plus fidèles à cette tendance sont, bien évidemment, les féministes. En réformiste et féministe, le président Essebsi se situe dans la tradition bourguibienne, à laquelle il demeure fidèle. Sa position trouve de nombreux partisans, en Tunisie et à l'étranger. C'est ainsi que les associations féministes égyptiennes ont appuyé l'initiative du président, de même que des intellectuels arabes libéraux comme Fatma Naout et Mohamed Chouhrour n'ont pas manqué de soutenir l'effort de la Tunisie pour parvenir à l'égalité entre les hommes et les femmes. Pour ce qui est du soutien en Tunisie, les associations de la société civile ont soutenu l'initiative de réforme, notamment la Ligue des droits de l'homme qui défend, dans son communiqué du 29 août, l'égalité entière entre les hommes et les femmes, en dénonçant la campagne des religieux et des conservateurs attachés à une conception figée du texte religieux et dévalorisante de la femme.
- La seconde position est précisément celle des conservateurs, qu'ils soient traditionalistes, islamistes, salafistes, ou citoyens musulmans identitaires. Ils ont la conviction que la charia inspirée du Coran et de la Sunna doit régir les relations humaines. L'islam étant à la fois religion et politique "Dîn wa dunya". Pour eux, le texte coranique ne supporte aucun "ijtihâd" ou "effort d'interprétation", étant donné que le message de Dieu est a-temporel ("salah li-kuli zaman wa makan"). Tel fut la position des détracteurs de Haddad, de Bourguiba et de tous les réformistes modernistes depuis le milieu du XIXème siècle. Il existe ainsi une tradition conservatrice dont la généalogie est à chercher du côté des Cheikhs déstabilisés par la modernité. Ceux qui s'en réclament aujourd'hui sont souvent à la recherche d'une identité imaginaire, vu que la dite Université fut convertie, au lendemain de l'indépendance nationale, en une université moderne et que ses enseignants actuels sont des universitaires et non des religieux. D'ailleurs, son président Hichem Grissa appela, en réaction au discours du Chef de l'État, à la constitution d'une commission charaïque et scientifique, composée de spécialistes, pour débattre des réformes proposées. Cette contre-proposition se situe au niveau symbolique pour exprimer un refus politique non assumé.
Il importe, à ce titre, de préciser que la plupart des religieux et des identitaires réfractaires à la réforme de la clause de l'héritage charriant un partage inégal argumentent leur discours en défendant l'idée, puisée chez les Fuqaha, que l'islam avait rehaussé le statut de la femme et que la réforme dite égalitaire est de nature à nuire à son "statut privilégié"!
Pour ce qui est de l'Université islamique de la Zaytouna, cette institution séculaire avait, au cours de son histoire passée, produit des savants, des imams et des intellectuels de toutes tendances, y compris les plus téméraires comme Tahar Haddad et Abul-Kacem Chebbi.
À regarder de près, les partisans du conservatisme se retrouvent politiquement du côté du mouvement islamiste d'Ennahda, des partis salafistes ainsi que du Hizb et-Tahrir prônant le Califat, sans oublier le parti Al-Mahabba dont le leader Hachmi Hamdi appela à la signature d'une pétition en vue de destituer le président, par la voie de l'Assemblée des représentants du peuple. Idéologiquement, les conservateurs défendent l'idée que "la femme est la gardienne de la tradition et de l'identité musulmane" et qu'elle doit être maintenue sous la coupe du mâle qui en est responsable, selon le texte coranique. Cette idéologie de la domination masculine est ancrée dans l'inconscient collectif et elle est davantage revigorée en temps de crise économique, politique et morale, comme ce fut le cas dans les années 1930, avec la publication du livre de Tahar Haddad.
Et comme c'est le cas de nos jours, avec la transition douloureuse que traverse le pays, de l'autoritarisme à la démocratie.
- Il existe une troisième position, plus nuancée par rapport aux deux positions tranchées de la polémique (modernistes vs conservateurs). Elle considère que la réforme proposée par le Président ne correspond pas aux exigences du moment, qu'elle obéit à un calcul électoraliste et qu'elle ne s'attaque pas à la racine des discriminations qui sont fondamentalement économiques et sociales, comme l'atteste la condition des femmes rurales. Nous retrouvons cette position chez Noureddine Tabboubi, le Secrétaire Général de la Centrale syndicale, qui considère que la véritable bataille n'est pas culturelle et religieuse mais plutôt socio-économique et sécuritaire. Du coup, l'initiative du Président est perçue comme non-prioritaire. Il est vrai qu'au sein de l'UGTT, les femmes occupent un rôle marginal au niveau du leadership qui est composé quasi-exclusivement d'hommes. Il est également vrai que la même position est courante chez les militants de gauche, les nationalistes arabes et nombre d'intellectuels réfractaires à l'esprit de réforme, sous prétexte que le réformisme est bourgeois et n'entraîne guère un changement radical de la condition féminine et sociale. En réalité, cette position ne fait que différer les réformes et reproduire les inégalités de genre et de classes. Elle s'oppose, sans le savoir ou sans le vouloir, au féminisme et aux idées émancipatrices du syndicaliste Tahar Haddad.
Aussi, le champ de la polémique n'est pas seulement structuré par la bipolarisation entre les sécularistes modernistes et les islamistes conservateurs. Il existe trois positions de principe qui peuvent, elles-mêmes, évoluer et changer au fil du temps. Il en est ainsi de la position d'Ennahda dont le leader, Rached Ghannouchi, était absent lors de la célébration de la fête de la femme à Carthage, alors qu'il est un allié stratégique du pouvoir et qu'il s'est distingué, depuis le dernier Congrès, par la revendication d'une séparation entre le politique et le religieux, en changeant de look et en arborant, pour la première fois de sa vie, une cravate bleue, portée à la française. Le porte-parole d'Ennahda, Imed Khemiri, voulant certainement rassurer la base, s'est limité à dire que le parti ne pouvait entériner une position contre la législation islamique ("charâ'").
Néanmoins, les autres dirigeants islamistes ont émis des jugements différenciés, oscillant entre la reconnaissance de la portée historique du discours présidentiel et la nécessité de consulter - par référendum? - le peuple sur une question aussi importante. Dans tous les cas, le parti Ennahdha se trouve confronté aujourd'hui à un dilemme: s'il accepte l'égalité successorale et matrimoniale, il perdra ses anciennes convictions "fréristes" et une partie de son électorat ; s'il refuse l'égalité au nom de la charia, l'idée d'une conversion politique vers un parti civil et démocratique s'avèrera une pure fiction.
L'avantage de la polémique est de mettre au clair les positions des protagonistes et de révéler les contradictions entre les alliés au pouvoir que sont les partis d'Ennahdha et de Nida Tounes. Il semble ainsi que les partisans d'un État civil à fondements séculiers auraient de plus en plus tendance à se distancier des partisans d'un État civil à fondements identitaires islamiques. Si cette tendance se confirme, la fragilité du "compromis historique" entre les islamistes et les sécularistes laisserait la voie libre à une nouvelle bipolarisation politico-idéologique et une rupture au sein de l'alliance au pouvoir. La Tunisie se dirigerait alors vers une nouvelle étape de transition, un "post-accord de Paris", scellé entre les "deux cheikhs", Essebsi et Ghannouchi, en 2013. N'est-ce pas dans ce sens que tend le discours présidentiel du 13 août ainsi que la réponse maquillée du leader d'Ennahdha, deux semaines après, plaidant pour la réhabilitation de l'institution des Awqaf - abolie par Bourguiba en 1956-7 - pour améliorer la qualité de l'enseignement.
Le constat final est que, malgré la véhémence symbolique des propos échangés entre les acteurs modernistes et conservateurs autour de la question de l'égalité hommes/femmes, il n'y a pas eu, cette fois-ci, des appels internes au "takfir" ou d'apostasie impliquant une déchéance de statut de musulman - qui était une pratique fréquente et désormais interdite par la loi - article 6 de la Constitution -, hormis la réaction violente du prédicateur égyptien exilé en Turquie, le salafiste Wajdi Ghoneim, contre l'initiative tunisienne officielle associée, de part le projet d'abroger la circulaire de 1973 et d'assurer l'égalité successorale, à une forme de mécréance ("kufr"). C'est pour cela qu'il appela au Djihad contre les laïcs tunisiens. Du coup, le gouvernement turc, dont l'ambassadeur à Tunis fut convoqué par le ministère des Affaires étrangères, semble vouloir sévir, en tentant un procès contre ce prédicateur salafiste.
Un autre imam islamiste, connu par ses prêches dans la chaîne qatarie "Al-Jazira", Youssef Qaradhawi, président de l'Union internationale des savants musulmans, n 'a également pas manqué l'occasion de s'opposer à l'initiative tunisienne considérée comme contraire aux règles de l'islam, lesquelles privilégient la femme dans trente cas de successions.
De son côté, un dignitaire de la mosquée d'Al-Azhar, Abbas Shuman, s'est positionné en émettant une fatwa contre la proposition de débat lancée par le président tunisien en vue de parvenir à l'égalité. S'il est vrai que cette position n'émane pas de la plus haute autorité d'El Azhar, en l'occurrence le grand imam Mohamed Ahmed at-Tayeb, mais d'un adjoint chargé des examens et des résultats, il n'en est moins vrai qu'elle exprime la pensée dominante au sein de cette institution religieuse. En cela, elle élargit le cadre de l'affaire qui ne se limite plus à l'échelle nationale. Du coup, des réactions hostiles à la dogmatique religieuse se sont imposées en Tunisie, en lançant le hashtag "Yezzi Al-Azhar" ("Al-Azhar, ça suffit"), évoquant tantôt le caractère purement national de la question, tantôt la tradition réformiste tunisienne qui tranche avec le reste du monde arabe, y compris l'Egypte où la polygamie est fréquente et où le statut des femmes laisse à désirer. D'ailleurs, l'adoption du CSP et la critique bourguibienne du jeûne de Ramadan ainsi que du sacrifice de l'Aïd furent attaqués et rejetés, à l'époque, par les hommes religieux du Moyen-Orient. Il n'empêche qu'elles ont changé en profondeur le pays et forgé l'identité tunisienne.
Malgré la violence verbale de certains propos, nous assistons aujourd'hui à un débat mesuré et décisif pour l'échange des points de vue au sein de l'espace public qui se veut pluriel et démocratique depuis l'avènement du "printemps arabe". La condition des femmes qui polarise le débat public se trouve, encore une fois, au cœur du politique et de sa transformation, par le biais d'un changement de rapports entre l'Etat et la société civile. Plus qu'auparavant, les femmes montent au créneau et exigent l'égalité. Les féministes ne sont plus seulement des hommes réformistes, mais aussi des femmes réclamant le droit de disposer de leur corps, de leur vie, par le libre choix. C'est là une véritable révolution qui annonce l'émergence fulgurante du "Monde des Femmes", pour reprendre le titre d'un ouvrage d'Alain Touraine.
Le souhait est que la polémique engagée s'élargisse et se transforme en véritable débat de société, ouvert à toutes les sensibilités, qu'elles soient civiles ou religieuses, dans le respect de l'altérité et la tolérance des différences.
3. Inégalité ou égalité entre hommes et femmes?
La véritable question traduisant le partage des positions politiques et idéologiques à l'égard des réformes successorales et matrimoniales proposées par le discours du Président de la République est celle relative à l'égalité entre hommes et femmes. C'est là que se trouve la question des questions. En proposant un débat autour des successions et du mariage de la musulmane avec le non-musulman, l'objectif est d'en finir avec l'inégalité de genre. Il s'agit de faire évoluer la condition féminine qui est déjà, en Tunisie, relativement avancée par rapport aux autres pays arabes et musulmans, pour atteindre l'égalité au niveau des droits et également des pratiques. La différence de salaires, de statuts, des idées et des images stéréotypées, véhiculées par les médias et par l'opinion commune, à l'égard des femmes reflète les discriminations professionnelles, sociales et culturelles qui persistent à travers le temps, malgré l'évolution de la condition féminine.
Les replis identitaires qui se traduisent par le voilement partiel et intégral des femmes ainsi que la valorisation de la cellule familiale et des modes d'appartenance infra-politique tels que le lignage, la religion et le local conduisent à la limitation des libertés individuelles, notamment celles des femmes.
En réalité, les deux logiques de l'ouverture et de la fermeture des espaces, des mentalités et des attitudes individuelles et collectives coexistent à l'ère de la globalisation. Une telle coexistence est compréhensible du point de vue de l'analyse mais inacceptable du point de vue de l'éthique politique. La question se pose alors de savoir comment accepter l'inacceptable qu'est la discrimination de genre?
Cette question n'est ni anodine, ni secondaire par rapport aux logiques sociales de reproduction de l'ordre politique. À l'orée du IIIème millénaire, la persistance des discriminations exprime le paradoxe de la modernité qui véhicule autant les valeurs de l'émancipation libérale que celles de l'enchaînement identitaire.
Si les statistiques plaident pour un changement de la condition féminine au niveau des études, du travail, des postes de décision et même des mentalités puisque l'idée galvaudée de "femme au foyer" est de plus en plus déclassée, des inégalités persistent à tous les niveaux, notamment dans les instances de pouvoir qui demeurent l'apanage des hommes. Il existe un attachement fort aux privilèges masculins au point que le combat des femmes exige des efforts titanesques, pour en finir avec la domination masculine, à visage tantôt découvert, tantôt voilé par le discours religieux et idéologique des hommes et des femmes.
En réalité, la religion contribue, par son discours transcendant, à reproduire l'idéologie patrilinéaire qui dure depuis des millénaires et à légitimer les inégalités sociales. Il en fut ainsi le long des siècles précédents, avec l'exhérédation des femmes à travers l'institution des biens de main-morte religieuse ("habous").
La discrimination à l'égard des femmes continue avec les pratiques contemporaines du mariage coutumier, de l'exclusion du "deuxième sexe" de l'espace public par le biais de la violence verbale, de l'idéologie prônant le respect des traditions ainsi que des inégalités du partage de l'héritage. Bien que l'islam accorda à la femme la moitié de la part de l'homme, dans la pratique, les femmes héritent de peu, voire n'héritent de rien, notamment dans les zones rurales, où il existe une séparation entre les genres même si ce sont les femmes qui sont les plus actives, sur le double plan professionnel et familial.
Le discours religieux a pour fonction de légitimer ce genre de pratiques discriminatoires, au nom de la "Loi charaïque" et de "la Tradition des ancêtres".
Ceci dit, tous les religieux ne sont pas réfractaires aux réformes successorales et matrimoniales. Certains ont pris position pour l'égalité, y compris du côté des islamistes et des salafistes, tels que le marocain Abdelwahab Rafiki alias Abû Hafs, Tarek Ramadan, Adnan Ibrahim...C'est dire que les positions dépendent souvent de l'interprétation que l'on fait du texte coranique dont les lectures varient selon le contexte historique et les convictions individuelles.
Par contre, il existe des acteurs politiques qui refusent de se situer au niveau du champ religieux et revendiquent le caractère civil de la question de l'égalité. Tel est le cas des anciens constituants qui ont signé un texte intitulé "De la suprématie de la Constitution" où ils ont rappelé les débats de la Constituante sur l'islam et l'État civil entre 2011 et 2014, en précisant que le débat actuel se situe en référence exclusive au droit positif d'un État sécularisé et qu'il s'agit de mettre fin à toutes les formes d'inégalités parmi les citoyens.
En tout cas, le champ du débat est suffisamment ouvert pour accueillir tous les avis, à condition d'accepter le principe du pluralisme. Quelle que soit la position doctrinale et politique, la question de l'égalité de genre est axiale dans la problématique des changements politiques, économiques et symboliques. La différence de sexe, comme la différence de couleur, justifie l'inégalité qui est légitimée au nom de la nature et de la religion alors qu'il s'agit de différences culturelles et de discriminations politiques. Les rapports changent à partir du moment où les victimes - les femmes, les noirs, les minorités... - décident de se prendre en charge, de défendre leurs droits et de refuser les inégalités. Le changement s'effectue au niveau des lois et également des idées et des pratiques qui mettent plus de temps mais qui sont décisives, en vue d'un changement effectif, horizontal et non pas vertical - du haut vers le bas, du pouvoir vers la société.
Les résistances au changement des rapports sociaux de genre sont l'expression d'une logique de pouvoir privilégiant les hommes au dépens des femmes. Ces résistances augmentent à mesure que le combat des femmes avance et acquiert des soutiens parmi les femmes et les hommes pour parvenir à inscrire, dans les faits, le principe d'égalité.
Pour conclure, il n'y a pas mieux que de référer à Tahar Haddad, le pionnier du féminisme tunisien, qui vient d'être réhabilité officiellement, en tant que notaire, fonction dont il fut déchu par la Commission de censure ("Nadhâra") de la Mosquée de La Zaytouna, de même qu'il mourut jeune, dans une solitude quasi-totale, en raison de ses idées anti-conformistes. Dans ses "Propos Libres" ("Khawâtir"), rédigées en 1933, il notait avec finesse et discernement que:
"Nous aimons et nous haïssons la femme. Nous l'aimons proie entre nos mains, dût-elle saccager notre existence. Mais nous ne voulons pas que la femme soit libre, adulte et responsable avec nous. Pourquoi ? Parce que nous sommes capables de nous procurer du plaisir en excitant nos sens, mais impuissants d'atteindre le plaisir en excitant notre âme et notre esprit".
http://www.huffpostmaghreb.com/mohamed-kerrou/trois-questions-pour-comprendre-la-polemique-autour-des-successions-et-du-mariage-de-la-musulmane-avec-le-non-musulman_b_17866200.html?utm_hp_ref=maghreb



 Accueil
Accueil

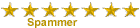













 Betina Garcia/Scanpix Denmark/AFP
Betina Garcia/Scanpix Denmark/AFP