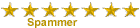[size=32]Mieux comprendre le désir d’islam dans les banlieues[/size]
Propos recueillis par Marie Chabbert - publié le 08/03/2018
Après neuf ans dans l’intimité des «jeunes des quartiers», le sociologue Fabien Truong publie Loyautés radicales*, une enquête ethnographique sur le rapport à la religion et à la violence des « mauvais garçons » de la nation.

 Éditions La Découverte
Éditions La DécouverteÀ l’heure où grandit la peur d’une « islamisation » des banlieues, le sociologue Fabien Truong a enquêté à Grigny et en Seine-Saint-Denis afin de mieux comprendre la soif de religiosité des «mauvais garçons» de la nation. Loin du sensationnalisme et des clichés véhiculés dans certains médias, le sociologue emmène le lecteur au cœur des quartiers, dans l’intimité de ces jeunes pour qui l’islam devient un moyen pour sortir de l’impasse, par le haut ou par le bas.
Quelle est la démarche de votre livre ?
Ce livre est le fruit d’une enquête. Je cherchais à en apprendre davantage sur ceux qui sont souvent perçus comme les «mauvais garçons» de la nation, les jeunes des cités, des milieux populaires, qui passent par des phases plus ou moins prolongées de délinquance. Plus précisément, je me suis focalisé sur ceux de ces garçons qui restent longtemps coincés dans la délinquance et ont du mal à en sortir. Ce n’est pas du tout la population majoritaire chez les garçons de cité. Mais elle existe, et elle grandit.
Je suis donc resté sur le terrain. Mon livre est le résultat de deux enquêtes qui se complètent. Je me suis d’abord lié avec des jeunes de Seine-Saint-Denis, dont deux en particulier que je suis aujourd’hui depuis neuf ans. La deuxième enquête, bien plus immersive, a duré deux ans. J’étais à Grigny plusieurs jours par semaine, le soir, la nuit, le matin, à des moments différents. Neuf ans d’enquête, et même deux, cela peut sembler très long. C’est pourtant le temps nécessaire pour apprendre à connaître les enquêtés, être capable de distinguer ce qu’ils vous disent et ce qu’ils font vraiment, et entrer véritablement dans une forme d’intimité. L’enquête ethnographique, ce n’est pas juste recueillir des témoignages et puis repartir. C’est tisser des liens.
C’était d’autant plus nécessaire que je m’intéresse à des sujets qui structurent les émotions personnelles : le rapport de ces jeunes à la religion et leur expérience de la violence. Cela soulève des questions liées à la métaphysique, à la subjectivité, et touche des choses très sensibles. Le geste de mon enquête, c’est donc d’emmener le lecteur sur ce terrain là, le terrain de l’intimité. C’est aussi pourquoi je resserre la focale sur six « garçons », six personnages principaux. Ce n’est pas du tout parce que je n’aurais rencontré que ces six garçons, c’est simplement qu’il me fallait pouvoir rentrer dans le détail de leur vie.
On apprend à connaître Hassan, Tarik, Radouane, Amada, Marley et Amédy. On pénètre dans l’intimité de leur quotidien, de leurs peurs et de leurs espoirs. C’est une expérience à la fois très forte et déstabilisante. Amédy est en effet Amédy Coulibaly, l’un des auteurs des attentats de janvier 2015. Pourquoi avoir souhaité le mettre sur un pied d’égalité avec les autres « mauvais garçons » ? Et pourquoi avoir voulu lui donner une humanité qu’il n’avait pas dans les médias ? N’avez-vous pas peur que, comme le suggérait Manuel Valls, chercher à comprendre soit déjà un peu excuser ?
Je n’ai pas fait ce livre avec un agenda derrière la tête. Les essayistes ont en général une thèse à démontrer et vont chercher des éléments pour appuyer cette thèse. Travailler sur le terrain, enquêter, c’est au contraire adopter une démarche inductive. Je ne suis pas arrivé à Grigny en me disant : « Je vais faire un livre sur Amédy Coulibaly ! » Ça ne s’est pas du tout passé comme ça. Si je parle d’ « Amédy » plutôt que d’Amédy Coulibaly, c’est tout simplement parce que c’est de ce garçon du coin et non de l’anti-star qu’on m’a parlé. C’est cela que s’en tenir au réel. Pour être clair, je n’ai jamais rencontré Amédy Coulibaly. Au moment où j’arrive à Grigny, il est déjà mort. Je mène donc une ethnographie post-mortem au travers du témoignage d’une quarantaine de proches qui m’ont permis de reconstituer un peu sa vie, comme le ferait un historien.
Il ne faut pas oublier que je me trouve alors dans un endroit où beaucoup de personnes ont vécu janvier 2015 comme une triple peine. La première peine est commune à tous : la sidération face à cet acte terrible, barbare. Mais la deuxième, c’est que c’est un garçon du coin qui a fait ça. Le quartier n’en est que plus stigmatisé. Des politiques ont parlé de Grigny comme d’une fabrique de terroristes. Enfin, troisième peine, dont on n’a pas parlé dans les médias, mais que j’ai tout de suite sentie, c’est qu’Amédy est un garçon qui avait été connu, aimé. J’ai rencontré certains de ses proches, de ses amis. Adama, un des six garçons suivis, était un de ses meilleurs copains. Il a pris une direction différente de celle d’Amédy bien qu’il ait vécu les mêmes galères. Il est aujourd’hui animateur. Ce duo en dit beaucoup sur ce à quoi peut tenir une trajectoire de vie.
Alors confondre expliquer et excuser, comme le fait Manuel Valls, c’est indécent. Évidemment, dans le moment de la sidération, des personnalités ont tenté « d’expliquer » en tenant des propos maladroits, voire obscènes, parce qu’ils n’avaient pas vraiment les clés en main. Il y a eu beaucoup de maladresse, de pétitions de principe. Mais il faut bien voir que la rhétorique de Daech est efficace parce qu’elle constitue un imaginaire politique latent décontextualisé. Refuser de chercher à comprendre, c’est jouer le jeu de cette décontextualisation. C’est s’exprimer comme Daech ; et on se retrouve à parler de musulmans mauvais par définition, de quartiers mauvais par essence, etc. Il est alors essentiel de recontextualiser ! Amédy, c’est un garçon de Grigny, pas de Daech ; il est français, il est d’ici, et il a un rapport à la religion et à la violence qui est le produit de notre société. Il faut donc essayer de comprendre ce qui s’est passé en mettant Amédy à hauteur des autres garçons, pour voir aussi comment certains s’en sortent tandis que d’autres restent coincés, pour identifier ce qui a pu jouer ou non, à tel ou tel moment clé. Mais cela n’a rien d’une excuse ! Comme je l’explique au début du livre, j’ai moi-même été touché personnellement par les attentats[l’auteur a perdu un ami au Bataclan, ndlr]. Il n’a donc évidemment jamais été question d’excuser ou même de justifier l’acte de Coulibaly. Cela serait tout aussi indécent.
Pensez-vous, comme Marley le suggère au début de votre livre, que ce soit le quartier qui rende les garçons « comme ça » ?
Cette phrase est très forte. À ce moment-là, Marley vient de lire mon premier livre (Des capuches et des hommes. Trajectoires de « Jeunes de banlieue », Buchet-Chastel, 2013). Cela peut sembler, de prime abord, assez improbable. Mais une de ses copines, que j’ai eue comme étudiante, le lui avait passé. Une rencontre qui s’est avérée particulièrement révélatrice. En lisant mon livre, Marley se rend compte qu’il a grandi dans un contexte fait de contraintes qui l’ont influencé, transformé. Le quartier produit un environnement social particulier qui affecte les subjectivités, les trajectoires, qui produit des contraintes tout à fait contradictoires. Elles se manifestent par des conflits de loyauté. Tous ces garçons-là ne peuvent se présenter de la même façon avec la plupart de leurs interlocuteurs. Ils vont adopter une mise en scène d’eux-mêmes très différente pour parler à un copain d’école, un collègue de business, un équipier rival, une petite copine, la maman, le papa, les parents des copains, les profs qu’on aime bien, les profs qu’on déteste, etc.
Le quartier n’est en cela pas différent du reste de la société, qui produit les mêmes loyautés contradictoires, mais le quartier étant à la marge de la société, ces contraintes y sont exacerbées. Chacun se débat avec ces loyautés contradictoires comme il le peut, pour trouver une forme de cohérence. Chacun apporte des réponses différentes, mais qui souvent suivent un même schéma.
C’est donc bien le quartier, et par extension la société, qui rend les garçons « comme ça », mais je récuse l’idée qu’il existe une « culture de banlieue ». Nombre de questions que se posent ces jeunes sont celles de toute une génération aujourd’hui. Après avoir lu mon livre, Marley a pris conscience de la difficulté pour des jeunes du quartier de fabriquer de la cohérence, et cela a ouvert un espace de conversation enrichissant, je crois, pour nous deux. Certains garçons se retrouvent empêtrés dans ces contradictions et ne parviennent pas à s’en sortir. Mais la plupart y arrivent, font des études, quittent le quartier. C’est l’objet de mon livre précédent (Jeunesses françaises : Bac+5 made in banlieue, Éditions de La Découverte, 2015). Alors attention, le quartier ne rend pas forcément les garçons « mauvais », loin de là.
La religion aide beaucoup dans cette affaire, en unifiant la vision que l’on porte sur soi-même. De façon très concrète, la religion propose des rituels. Quel que soit le lieu, quelle que soit la situation, le rituel astreint aux mêmes choses. Cela donne une régularité, une prévisibilité. La moralité religieuse est aussi d’un grand secours. Les garçons coincés dans la seconde zone ont une très forte conscience que ce qu’ils font n’est pas « bien ». Le romantisme du bandit fier qui roule des mécaniques n’est qu’une mise en scène. Dans l’intimité, se joue la difficulté de se regarder dans une glace. Le fait de se percevoir comme un être moral et de pouvoir se racheter est alors essentiel.
La religion n’est donc pas forcément à blâmer, selon vous, dans l’émergence de terroristes « maison », c’est-à-dire de terroristes ayant grandi en France…
Pour commencer, il faut réaliser que parler de « la religion », ça n’a pas de sens ! La religion est une interprétation d’une collection de textes sacrés. Ces interprétations sont humaines et sociales. Se positionner sur « la religion » sans distinguer la multiplicité des interprétations individuelles, c’est donc déjà faire un contre-sens ! À l’inverse, je souhaitais comprendre comment ces jeunes des quartiers interprètent les textes, ce qu’ils y cherchent et ce qu’ils y trouvent. Or, il apparaît que l’islam, chez ces jeunes, est soit un élément qui alimente la mise en spectacle de la rupture, soit un médium aidant dans la désistance, c’est-à-dire à une sortie de la délinquance et une forme de pacification intérieure. Le premier cas est de loin le plus rare, mais il est bien plus visible et plus médiatisé. Contrairement à ce que l’on veut bien croire, l’islam est en général un vecteur d’apaisement personnel, parce qu’il répond à des questions restées sans réponses et joue ainsi un rôle métaphysique, intellectuel, esthétique et politique essentiel.
Dans les quartiers, il n’existe pas de lieux où l’on peut discuter de questions métaphysiques. On ne prend pas ces questions au sérieux, mais la question de la mort, par exemple, est centrale chez ces jeunes. Ils ont tous fait l’expérience de la mort brutale en perdant des copains, assassinés. Les pères ont toutes les chances de mourir prématurément, brisés par un travail trop pénible. Tout cela soulève des questions métaphysiques : celle du deuil, de la culpabilité, de l’injustice. Or, trop peu de personnes donnent de réponses à ces questions, ou les travaillent. Dans d’autres contextes, si des personnes avaient subi un dixième de la violence que ces jeunes ont subie il y aurait eu des cellules psychologiques, des accompagnements. Là, il n’y a rien. Amédy Coulibaly, par exemple, n’a jamais pu faire le deuil de son ami Ali, tué sous ses yeux par un policier. Il ne cultivait pas seulement une haine de la police, dont on a beaucoup parlé dans les médias, il était aussi persuadé qu’il aurait dû partir à la place de son copain. C’est ce que ses proches et ses amis m’ont répété. La religion peut être d’un grand secours dans ce genre de situations. Elle aide à traverser le deuil, à se poser la question de l’injustice face à la mort. Mais aussi des questions éthiques.
Tous ces jeunes vivent avec un sentiment de souillure énorme. Le vocabulaire de la saleté est omniprésent. La volonté de se laver est donc très forte chez eux. Or, c’est ce que permet l’islam : se racheter petit à petit, en accumulant des bonnes actions. Il y a aussi, bien sûr, la dimension intellectuelle. On croit souvent que les personnes qui se jettent dans la religion sont des demeurés, encore plus s’ils viennent de banlieues et qu’ils ont quitté l’école à 16 ans. Mais ce que la religion offre à ces jeunes, c’est en fait l’occasion de retrouver, à tort ou raison, une sensation d’élévation intellectuelle perdue depuis qu’ils ont arrêté l’école. Le rapport à la lecture, les débats entre amis au sujet de tel ou tel précepte. C’est très précieux pour ces jeunes, à l’instar de l’expérience de la beauté dans le texte sacré, la sublimation, dans un environnement sale, délabré, gris. Enfin, il existe la question politique. La religion répond au besoin de construire un autre monde, meilleur, en proposant des utopies. La politique actuelle n’en propose plus depuis longtemps, en particulier à ces jeunes considérés comme déjà perdus.
La religion n’est donc pas un opium pour cette jeunesse-là. Elle ne l’empêche pas de prendre conscience de sa domination, mais lui donne plutôt une nouvelle signification. Alors, bien sûr, parce qu’il existe ce désir très fort de religiosité, certaines personnes en profitent en donnant une interprétation de la religion qui sert un agenda politique défini au service de l’intolérance la plus crasse. C’est le cas des fondamentalistes religieux qui prêchent une religion radicale dans les quartiers, mais aussi des essayistes des quartiers cossus lorsqu’ils parlent de « la religion » sur les plateaux de télévisions. Ils donnent une interprétation personnelle des textes sacrés, la leur, qui sert leurs intérêts.
La religion peut être le moyen d’une pacification, mais aussi l’occasion d’une rupture, ce que l’on appelle aujourd’hui la « radicalisation ». Vous écrivez que, dans ce cas, « le “radicalisé” refuse de réancrer l’islam à son passé. Il cherche à rester dans l’effervescence de la conversion, évitant l’épreuve sociologique de la reconversion ». Qu’entendez-vous par là ?
Les termes de « conversion » et « reconversion » sont ceux employés par les jeunes eux-mêmes. Je fais de ces termes des concepts sociologiques parce qu’ils permettent de reconsidérer les définitions un peu paresseuses du processus de conversion religieuse et de « radicalisation ». À l’heure actuelle, on distingue les Obélix de l’islam – ceux qui seraient tombés dedans quand ils étaient petits – des autres, dits « convertis ». Sur le terrain, cette différence n’existe pas vraiment. La grande majorité des garçons passent tous par une phase de « conversion ». Même si leurs parents les ont élevés dans l’islam, la religion les intéresse peu en général, jusqu’à ce qu’ils la redécouvrent tout à coup, pour diverses raisons.
Le rapport de ces « convertis » est toujours excessif. On réalise que la religion était le truc le plus important de la terre, mais qu’on ne s’y est jamais vraiment intéressé, et que des milliers d’interprétations différentes nous sont proposées. On a alors tendance à en faire dix fois trop. On en vient à sermonner les parents parce qu’ils ne pratiquent pas « assez », ou pas assez « bien ». On est alors dans une effervescence presque violente. Celle-ci conduit à une forme de spectacle, voire d’agressivité, parce qu’on est dans l’instant de la rupture. On veut se défaire de sa vie d’avant pour s’abandonner totalement à la transformation. D’autres pratiques peuvent servir des mécanismes similaires : faire du yoga non-stop et se mettre à ne manger que des fruits secs de manière militante suivrait une même logique de révélation quasi-spirituelle que l’on a tendance à vivre dans l’excès. Cela est particulièrement exacerbé dans nos sociétés contemporaines du spectacle, où les réseaux sociaux et les médias sont omniprésents. La logique du capitalisme nous pousse aussi à prendre part à cette surenchère.
Mais le fait est que la conversion, dans le temps long, est trop fatigante. On peut difficilement rester dans cette effervescence. Vient alors en général le moment difficile de la « reconversion », où la révélation religieuse doit être réancrée à son passé, réarticulée à des projets et aux personnes qui nous entourent. C’est là que la religion se complexifie, se bricole et s’apaise. Tarik boit de l’alcool, Hassan pas du tout, mais ils sont tout aussi engagés dans leur religiosité. Cette reconversion se fait dans l’intimité, loin des caméras avides de sensationnalisme. Cependant, dans quelques cas plus rares, le jeune va refuser le coût sociologique de la reconversion. Pour certains jeunes qui ont trop fait de « sale », qui sont restés trop longtemps dans la seconde zone, il est trop difficile d’accepter son passé et de construire un nouveau futur. C’est moins coûteux de rester dans le spectacle, d’accepter l’impasse en la sublimant que de s’efforcer de se reconstruire. C’est cela qu’on appelle aujourd’hui la « radicalisation » des « terroristes maison » et c’est cela qui est à l’origine du geste de Coulibaly.
(*) Loyautés radicales. L’islam et les « mauvais garçons » de la nation. Fabien Truong (Éditions La Découverte, 2017)

 Accueil
Accueil