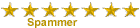Comment Pétain est devenu le héros de Verdun Avant même la fin de la guerre, s’est forgée la légende de l’«homme de la défensive», celui qui avait gagné la bataille de la Meuse en épargnant le sang des soldats… Mais quel fut exactement le rôle de l’ambitieux général dans le tumulte de 1916 ?
Avant même la fin de la guerre, s’est forgée la légende de l’«homme de la défensive», celui qui avait gagné la bataille de la Meuse en épargnant le sang des soldats… Mais quel fut exactement le rôle de l’ambitieux général dans le tumulte de 1916 ?
La gloire ne s’est pas fait attendre. «Qui n’a entendu raconter l’arrivée du général Pétain à Verdun, par la neige, un soir d’hiver ?» s’exclame ainsi l’un des grands quotidiens de l’époque, L’Echo de Paris, dans son édition du 7 janvier 1917. A peine un mois après la fin de la bataille, la légende est déjà en marche. Le dithyrambe ne faiblira plus, qui va faire du «sauveur de Verdun» pour longtemps le plus populaire des généraux français de la Grande Guerre.
Cette gloire, Philippe Pétain, en 1914, ne s’y attendait guère, ne l’espérait plus. A vrai dire, ce colonel de 58 ans, déjà proche de la retraite, s’en souciait assez peu. Sa carrière de militaire en temps de paix – lente pour cette raison – n’en a pas moins été honorable, même plutôt brillante. Né en 1856 dans une famille de paysans picards, saint-cyrien à 20 ans, il appartient durant sa jeunesse et sa maturité à «une armée décidée à tirer résolument les leçons de la défaite de 1870», écrit l’historienne Bénédicte Vergez-Chaignon dans une biographie très documentée (Pétain, éditions Perrin, 2014). Peu tenté d’accélérer son avancement en contribuant à la construction de l’empire colonial en Afrique et en Asie, cet officier sans combat, mais qui rédige et réfléchit bien, mène une carrière surtout intellectuelle.
Il est l’un des rares à pressentir l’importance de l’artillerie et de l’aviationA partir de 1901, durant une dizaine d’années, il instruit l’élite des officiers à l’Ecole de guerre. Il y développe une théorie nourrie par les réflexions que lui inspirent la guerre des Boers (1899-1902) et la guerre russo-japonaise de 1905. A la doctrine, qui prévaut au grand état-major, de l’offensive à tout prix, il oppose la prépondérance du feu, c’est-à-dire de l’artillerie. L’armement moderne, à ses yeux, a rendu contre-productif cette «sorte de marée montante qui doit s’avancer inébranlable sous le feu». C’est, dit-il, durant un de ses cours donné à l’Ecole de guerre vers 1910 «l’attaque à coup d’hommes dans sa manifestation la plus brutale, une espèce de jeu de massacre». Il faut privilégier les positions en profondeur contre le maintien meurtrier des positions en première ligne. Bref, l’élément moteur de l’offensive, à l’ère industrielle, ce ne sont plus les hommes – qu’il faut préserver, les ressources humaines n’étant pas inépuisables –, c’est la technique : «L’artillerie conquiert, l’infanterie occupe.» Il va jusqu’à s’intéresser à l’aviation comme instrument de reconnaissance. Mais aussi parce qu’elle permettrait d’accroître la portée de l’artillerie terrestre. A la même époque, le futur maréchal Foch déclare devant un journaliste que l’aviation militaire n’a aucun avenir : «Tout ça, voyez-vous, c’est du sport, mais pour l’armée, c’est zéro.» Ces théories nouvelles, le colonel les expose lors de cours fréquentés par le gotha de l’armée, avec une force de conviction qui ne lui vaut pas que des amis. Il emporte l’adhésion de plusieurs hauts gradés et d’un tout jeune saint-cyrien qui, en 1912, sert sous ses ordres et le reconnaît comme son maître, Charles de Gaulle.

En août 1914, Pétain a cru comme tout le monde que la guerre serait courte – quelques semaines, tout au plus. Le théoricien passe à la pratique et les résultats sont là : il couvre avec efficacité la retraite du général Lanrezac en Belgique ; il participe en septembre à la victoire de la Marne en prônant l’importance de l’artillerie et le recours à l’aviation ; il est le seul à réussir une percée du front allemand en Artois, le 9 mai 1915 ; enfin, Pétain se distingue en septembre lors de la nouvelle offensive (qu’il a formellement désapprouvée) lancée en Champagne par Joffre, ce qui oblige le généralissime à reconnaître «son sens très exact des réalités». La réalité, c’est que cette première année de guerre est catastrophique pour l’armée française, saignée à blanc, puis enlisée dans les tranchées. Si le colonel, en ces quelques mois, a gravi les derniers échelons de la hiérarchie militaire – général de brigade, puis général de division, enfin général commandant la 2e armée – c’est que Pétain, comme l’écrit Henri Amouroux (Pétain avant Vichy, éd. Fayard, 1967), «avance moins grâce à ses succès que par les défaites des autres. Pour le jeter au premier plan, il faudra l’extrême péril».

Et c’est le tonnerre de Verdun. L’attaque frontale des Allemands, le 21 février 1916, contre ce complexe fortifié, est d’une brutalité à laquelle on ne s’attendait pas Sous les monstrueux coups de boutoir de l’artillerie allemande, la panique gagne jusqu’au Grand Quartier général de Chantilly (GQG), où Joffre est retenu de sonner la retraite par Aristide Briand, accouru de Paris. Selon le président du Conseil, il faut, pour le moral de la nation, après les terribles sacrifices de l’année précédente, tenir à tout prix. Joffre, sur les conseils de son bras droit, le général de Castelnau (voir "Édouard de Castelnau, premier défenseur de Verdun" à la fin de l'article), se tourne alors vers celui qu’il tient en réserve depuis l’offensive en Champagne : le général Pétain et la 2e armée – des troupes fraîches, commandées par un homme que n’a pas encore contaminé le vent de panique qui souffle sur la Meuse. Le 25 février au matin, au GQG de Chantilly qui lui semble une «maison de fous», Pétain est reçu par un Joffre imperturbable : «Eh bien ! Pétain, vous savez que ça ne va pas mal du tout !» En fait, le généralissime soupçonne que Verdun, pour le général allemand von Falkenhayn, est un objectif secondaire, une opération de diversion. Et qu’il faut s’attendre à des attaques sur d’autres points du front. A moins qu’il s’agisse pour les Allemands de prévenir les offensives alliées en sapant le moral des Français. Il faut donc tenir Verdun, mais pas au point de compromettre la stratégie globale de l’Entente, c’est-à-dire l’offensive que Joffre prépare avec les Anglais sur la Somme. Tel est le litige qui va opposer les deux hommes.
 Contrairement à Joffre, il estime que si Verdun tombe, le sort de la France est scellé
Contrairement à Joffre, il estime que si Verdun tombe, le sort de la France est scelléPétain arrive à Souilly, son nouveau quartier général, au sud de Verdun, le 25 février au soir, alors que le fort de Douaumont vient de tomber. Atteint d’une double pneumonie, grelottant de fièvre, mais bien secondé par son état-major et par le général de Castelnau, il envisage rapidement et froidement la situation. Il entreprend aussitôt d’organiser une «position de résistance» pour une bataille qu’il pressent longue. Ces mesures visent à assurer la logistique, à rééquilibrer les forces d’artillerie (de cinq contre un en faveur des Allemands), à limiter l’usure des divisions engagées en assurant la relève régulière des unités combattantes dès qu’elles ont perdu un tiers de leurs effectifs. C’est ainsi que pendant dix mois, les deux tiers de l’infanterie française seront acheminés de Bar-le-Duc à Verdun par la Voie sacrée.

La vision qu’il a de cette bataille diffère du tout au tout de celle de Joffre. Pour Pétain, les Allemands ont réellement l’intention de prendre Verdun, d’ouvrir une brèche vers le sud, de couper l’armée française en deux et, après ce coup comparable à celui de Sedan en 1870, de foncer sur Paris. L’enjeu est énorme. L’issue de la guerre en dépend. Il ne s’agit pas d’une défense symbolique ou simplement morale, il faut empêcher une percée qui risque d’entraîner la capitulation d’une bonne partie de l’armée française. L’héroïque sacrifice des premiers défenseurs (notamment des deux bataillons de chasseurs du lieutenant-colonel Driant) lui a offert un précieux répit. «Il était moins cinq», écrira-t-il. Désormais, il faut tenir, durer, jusqu’à ce que l’ennemi s’use à son tour.
 « Courage, on les aura ! » : son cri de résistance lui vaut l’admiration des poilus
« Courage, on les aura ! » : son cri de résistance lui vaut l’admiration des poilusJoffre approuve ces premières dispositions, puis s’inquiète de cette stratégie purement défensive, dévoreuse d’hommes et de matériels. Les 1er et 5 mars, en visite à Verdun, il exhorte Pétain à reprendre le terrain conquis par les Allemands. Son opinion est que l’effet de l’artillerie doit être «ramené à sa juste valeur» qui est inférieure au «facteur moral» : en substance, que l’importance des dégâts compte moins que l’enthousiasme crée par l’énergie d’une offensive. Il faut attaquer. Pétain est d’un avis contraire. La situation a empiré, les pertes s’aggravent. Du 5 au 9 mars, puis du 10 au 15, puis du 20 au 22, enfin les 9 et 10 avril, il doit faire face à d’épouvantables assauts. C’est l’enfer d’une bataille sans cesse recommencée. Son ordre du jour du 9 avril se termine par un «Courage, on les aura !» qui retentit dans toute la France. De fait, l’attaque allemande marque le pas. Les hommes du Kronprinz s’enlisent. Cependant, à Chantilly, Joffre s’impatiente. Pétain donne à cette bataille interminable et coûteuse une «importance exagérée». Il faut en finir. Pourquoi tarde-t-il à retourner la défense en offensive ? «Pétain la pétoche», murmure-t-on. Au fond, il est «plus un organisateur qu’un chef militaire». Le général Brugère note que «Pétain serait surfait». Finalement, ne pouvant évincer l’artisan (déjà très célèbre) de ce qui est tout de même un succès, Joffre l’éloigne en lui offrant une promotion. Le 1er mai, Pétain est nommé commandant du Groupe d’armées du Centre, avec 800 000 hommes sous ses ordres, dont ceux de l’armée de Verdun, qu’il ne commandera plus directement.

Sur le terrain lui succède le général Nivelle, secondé par le général Mangin. C’est alors, de mai à juillet, sous leur direction, en dépit des mises en garde répétées de leur prédécesseur, une suite d’offensives qui sont autant d’échecs sanglants. Il faut attendre septembre, l’offensive qui a commencé sur la Somme, les opérations qui ont repris en Russie (offensive Broussilov) et le remplacement de Falkenhayn par Hindenburg, pour que Nivelle et Mangin, le 25 octobre, reprennent Douaumont contre une 5e armée allemande démoralisée. On revient peu à peu à la ligne de front de février 1916. Ce n’est pas exactement une victoire française, mais c’est un échec allemand. La gloire en revient à Nivelle et Mangin – Nivelle le «massacreur», Mangin le «mangeur d’hommes», comme les ont surnommés les poilus. Ils sont officiellement déclarés les «vainqueurs de Verdun», jusqu’à ce mois d’avril 1917 où leur obsession de l’offensive se fracasse dans la Somme sur le Chemin des Dames : 70 000 tués pour rien. C’est alors l’irrésistible retour dans le cœur de l’opinion de celui qui, dans «l’extrême péril», a su manier «l’art du réel et du possible» (selon de Gaulle). Pétain réprime (avec mesure) les mutineries de centaines de soldats désespérés, remonte le moral de l’armée et décide, comme à Verdun en 1916, de gagner du temps : «J’attends les Américains et les chars.» «Il fut le plus humain et le plus proche de notre misère», dira un député de gauche, Pierre Cot, lorsque Pétain sera nommé ministre de la Guerre en 1934. Cette parole d’un rescapé de l’enfer exprime bien l’admiration que portaient encore les poilus et l’empreinte qu’il laissa dans les esprits. Les députés s’en souviendront lorsqu’ils accorderont les pleins pouvoirs au vieux maréchal en 1940.
 Source
Source : Historia



 Accueil
Accueil